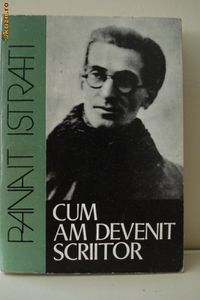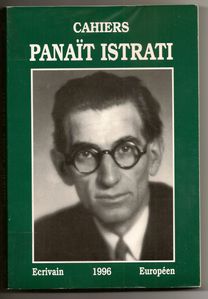Et maintenant, pourquoi ma pensée va-t-elle, parmi tant d’autres écrivains, vers le poète Roger Gilbert-Lecomte ? Lui aussi, la foudre l’a frappé à la même période que les deux précédents, comme
si quelques personnes devaient servir de paratonnerre pour que les autres soient épargnés.
Il m’est arrivé de croiser le chemin de Roger Gilbert-Lecomte. Au même âge, j’ai fréquenté comme lui les quartiers du sud : boulevard Brune, rue d’Alésia, hôtel Primavera, rue de la Voie-Verte…
En 1938, il habitait encore ce quartier de la porte d’Orléans, avec une juive allemande, Ruth Kronenberg. Puis en 1939, toujours avec elle, un peu plus loin, le quartier de Plaisance, dans un
atelier au 16 bis rue Bardinet. Combien de fois ai-je suivi ces rues, sans même savoir que Gilbert-Lecomte m’y avait précédé… Et sur la rive droite, à Montmartre, rue Caulaincourt, en 1965, je
restais des après-midi entiers dans un café, au coin du square Caulaincourt, et dans une chambre de l’hôtel, au fond de l’impasse, Montmartre 42-99, en ignorant que Gilbert-Lecomte y avait
habité, trente ans auparavant…
À la même époque, j’ai rencontré un docteur nommé Jean Puyaubert. Je croyais que j’avais un voile aux poumons. Je lui ai demandé de me signer un certificat pour éviter le service militaire. Il
m’a donné rendez-vous dans une clinique où il travaillait, place d’Alleray, et il m’a radiographié : je n’avais rien aux poumons, je voulais me faire réformer et, pourtant, il n’y avait pas de
guerre. Simplement, la perspective de vivre une vie de caserne comme je l’avais déjà vécue dans des pensionnats de onze à dix-sept ans me paraissait insurmontable.
Je ne sais pas ce qu’est devenu le docteur Jean Puyaubert. Des dizaines d’années après l’avoir rencontré, j’ai appris qu’il était l’un des meilleurs amis de Roger Gilbert-Lecomte et que celui-ci
lui avait demandé, au même âge, le même service que moi : un certificat médical constatant qu’il avait souffert d’une pleurésie — pour être réformé.
Roger Gilbert-Lecomte… Il a traîné ses dernières années à Paris, sous l’Occupation… En juillet 1942, son amie Ruth Kronenberg s’est fait arrêter en zone libre au moment où elle revenait de la
plage de Collioure. Elle a été déportée dans le convoi du 11 septembre, une semaine avant Dora Bruder. Une jeune fille de Cologne, arrivée à Paris vers 1935, à vingt ans, à cause des lois
raciales. Elle aimait le théâtre et la poésie Elle avait appris la couture pour faire des costumes de scène. Elle avait tout de suite rencontré Roger Gilbert-Lecomte, parmi d’autres artistes, à
Montparnasse…
Il a continué à habiter seul dans l’atelier de la rue Bardinet. Puis une Mme Firmat qui tenait le café, en face, l’a recueilli et s’est occupée de lui. Il n’était plus qu’une ombre. A l’automne
1942, il entreprenait des expéditions harassantes à travers la banlieue, jusqu’à Bois-Colombes, rue des Aubépines, pour obtenir d’un certain docteur Bréavoine des ordonnances qui lui
permettraient de trouver un peu d’héroïne. On l’avait repéré au cours de ses allées et venues. On l’avait arrêté et incarcéré à la prison de la Santé, le 21 octobre 1942. Il y était resté
jusqu’au 19 novembre, à l’infirmerie. On l’avait relâché avec une assignation à comparaître en correctionnelle le mois suivant pour « avoir à Paris, Colombes, Bois-Colombes, Asnières, en 1942,
acheté et détenu illicitement et sans motif légitime des stupéfiants, héroïne, morphine, cocaïne… ».
Début 1943, il a demeuré quelque temps dans une clinique d’Épinay, puis Mme Firmat l’a hébergé dans une chambre au-dessus de son café. Une étudiante à qui il avait prêté l’atelier de la rue
Bardinet pendant son séjour en clinique y avait laissé une boîte d’ampoules de morphine, qu’il a utilisée goutte à goutte. Je n’ai pas retrouvé le nom de cette étudiante.
Il est mort du tétanos le 31 décembre 1943 à l’hôpital Broussais, à l’âge de trente-six ans. Des deux recueils de poèmes qu’il avait publiés quelques années avant la guerre, l’un s’appelait
La Vie, l’Amour, la Mort, le Vide et le Vent.
Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard, Paris, 1997.